Développement durable et RSO
L'environnement : 3ème pilier de l'olympisme
Au cours des années 1990, le Comité international olympique (CIO) a ajouté une dimension environnementale nouvelle à l'Olympisme; un troisième pilier du Mouvement olympique qui rejoint le sport et la culture...
Découvrir
L'Agenda 21 du sport français
La présentation de l’Agenda 21 du sport français s’est déroulée, le 18 décembre 2003, au siège du CNOSF, à Paris.
Découvrir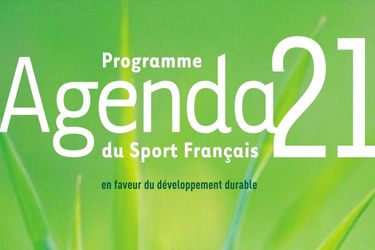
La charte du sport français pour le développement durable
Découvrir.jpg)
Du développement durable à la responsabilité sociétale du mouvement sportif
Présenté initialement comme le croisement des trois sphères, économique, sociale et environnementale, le concept de développement durable, apparu dans les années 1970, s’est ensuite développé autour d’une vision volontariste et transversale, affirmant ainsi ses deux finalités premières que sont l’équilibre des territoires et l’épanouissement humain.
Découvrir
La plateforme RSO, pour un sport écoresponsable
Le mouvement sportif porte depuis de nombreuses années des ambitions fortes en matière d’utilité sociale et de responsabilité sociétale (RSO)
Découvrir
La RSO n'est pas une nouveauté pour le mouvement sportif
Le mouvement sportif porte depuis de nombreuses années des ambitions fortes en matière d’utilité sociale et de responsabilité sociétale.
Découvrir
La démarche RSO du CNOSF
La RSO étant une stratégie d’amélioration continue, le CNOSF progresse petit à petit pour devenir, chaque année, un peu plus écoresponsable et capitalise sur ses propres échecs et expériences pour partager des bonnes pratiques avec ses membres.
Découvrir
Le coach climat évènements: l’outil pour un sport bas carbone.
Dans le cadre de l’héritage de Paris 2024 afin d’accompagner les acteurs du monde du sport dans leur transition écologique, Paris 2024, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ont développé le « Coach Climat évènements », un outil en ligne pour aider les évènements sportifs français à réduire leur empreinte carbone.
Découvrir
Demande de label "DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S'ENGAGE®"
Ce Label atteste du sérieux de votre démarche d’amélioration continue écoresponsable. Il vous permet de structurer votre plan d’actions puis de donner du poids et de rendre visibles vos engagements.
Découvrir
.jpg)